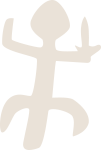« Le terrain collectif, je pense que c’est un des souvenirs les plus importants et le plus vifs que je garde. Le fait d’enfin travailler à plusieurs, ce dont on avait discuté en cours, mais qu’on avait très peu eu l’occasion de mettre en pratique pendant le master. Je trouve que, le terrain collectif, ça nous permet d’appréhender un peu qu’est-ce que c’est de faire de l’ethnographie à plusieurs. C’était hyper agréable parce que j’ai fait ça avec deux amies. On était un groupe de cinq, mais y’avait deux de mes meilleures amies de la promo. On a à la fois beaucoup ri, beaucoup travaillé, peu dormi, mais voilà c’était un très très bon souvenir. »
« Alors nous, notre année, on est allés au Pays de Bitche. On avait des thématiques de recherche, avec mon groupe on a travaillé sur le paysage sonore du pays de Bitche. Donc on a travaillé à plusieurs sur cette notion là de paysage sonore, on a essayé de récolter un maximum les sons qu’il y avait en pays de Bitche. C’est pour ça, vu qu’on avait un terrain qui n’était que d’une semaine, [que] c’était quand même extrêmement pratique d’être cinq. Heureusement qu’on était plusieurs. Donc ça nous a aussi permis de nous rendre compte à quel point c’est utile de travailler à plusieurs, surtout quand on a des terrains qui sont restreints dans le temps. […] Je trouve que ce qui a été peut-être le plus riche, au-delà de l’enquête en elle-même, c’était pendant les périodes d’analyse des données où chacun, chacune avait des ressentis très différents du terrain, ce qui a été extrêmement riche d’un point de vue réflexivité. On a pu beaucoup discuter entre nous sur pourquoi on avait ressenti le terrain de telle ou telle manière et ça nous a aussi permis de penser différemment les résultats de l’enquête. »