« C’est très large, ça dure 14 mois, donc c’est très condensé et le but c’est vraiment d’avoir les bases de la sommellerie, donc les connaissances de toutes les régions, techniques de vinification, les labels, techniques de vente, le commerce, techniques de dégustation aussi et les spiritueux qui viennent en fin de formation, ainsi que tous les autres types d’alcool et boissons en dehors du vin. »
« Parfois on voyage. Vu que cette école est basée sur l’intuitif, on utilise des bandeaux pour avoir des images personnelles [lors de dégustation] et moi j’adore travailler sur l’imagination, j’ai beaucoup d’imagination, j’écris aussi à côté. En fait, le vin, c’est raconter des histoires, c’est essayer de les partager et, en même temps, de s'imprégner de celles des vignerons pour que ça puisse parler a plein de personnes. C’est tellement génial. On a cette mission, en tant que caviste ou sommelier, de partager ça avec les autres. »
« Là je suis en apprentissage chez un caviste, donc j’apprends le métier de la vente, en même temps l’animation de certaines soirées de dégustation, l’envers du décor du métier, que ce soit l’organisation, les stocks, etc… Mais après cette formation, j’aimerais peut-être me diversifier pour une pratique un peu plus pratico-pratique dans les vignes ou alors en restauration pour faire du conseil client au niveau du vin et des accords mets-vin. »
« Là où je travaille actuellement, c’est le seul endroit où j’ai vraiment senti que le patron allait me transmettre des connaissances. Le monde de l'apprentissage, ça reste parfois un peu fourbe, le maître d’apprentissage n’est pas toujours présent, ça dépend des entreprises, encore une fois c’est le monde du travail, c’est pas facile. Et eux m’ont vraiment rassuré parce qu’ils m’ont dit « de toute façon vous ne serez jamais seule et on va vous suivre, on va vraiment vous transmettre tout ce qu’on sait le plus possible ». Et j’ai senti que si j’allais chez eux, j’allais apprendre. »

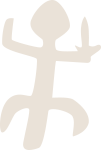
![<em>[photo de terrain] Magdalèna Belz, "Parcelle de vigne sauvage", Maison Lissner à Wolxheim, 28 octobre 2021. </em>](/websites/ethnologie/Documents/_En_Quete_Professionnelle_-_Noemie/Photo_Magda.jpeg)