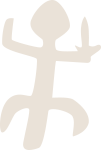Après sa soutenance de master en décembre 2019, Étienne prend la décision de déménager à Marseille. Après plusieurs remises en question d’ordre personnel, il décide de s’orienter vers les métiers du monde de l’appui à la recherche.
« J’ai abandonné le CAPES au moment des épreuves, j’ai rendu une copie blanche à l’une des épreuves. Je me suis dit « merde, qu’est-ce que je vais faire ». À ce moment-là je me suis dit que j’avais peut-être envie de remettre un pied dans le monde de la recherche, mais pas en tant que chercheur, en tant que personnel d’appui ou de soutien à la recherche. Donc ce que je fais actuellement. On est les personnes qui permettent aux chercheurs de faire de la recherche et sans qui il ne pourrait pas y avoir de recherche. On est beaucoup plus nombreux et nombreuses que les chercheurs, au CNRS ou dans les universités. Donc c’est tout le personnel en fait qui ne fait pas de la recherche. Et donc là j’ai commencé à faire une petite veille sur les plateformes de l’INRAE, de l’IRD, du CNRS, d’Aix-Marseille Université -parce qu’ils ont des portails emploi, ce qu’il faut savoir - Et je suis tombé un peu par hasard sur ce poste et je me suis dit « bah tiens, ça correspond à mon profil ». J’avais une petite connaissance du monde de l’édition académique parce que j’avais eu l’opportunité de publier des articles et comptes rendus d’ouvrages pendant mon cursus et de participer aussi à un projet d’actes d’une journée d’étude interannée qui avait été organisée par l’association étudiante en partenariat avec l’institut. Et donc là, je suis en poste au CNRS et je suis employé chez OpenEditions, c’est en gros Cairn, mais public. [...] Je m’occupe des revues qui arrivent, des éditeurs qui arrivent sur la plateforme, qui veulent être diffusé sur OpenEdition et je fais de la recherche d’experts, je fais moi-même des retours sur des dossiers de candidature pour des revues en SHS, donc toutes disciplines confondues, du droit à la philosophie, en passant par l’histoire, le sport, des revues de recherches en pédagogie, etc.. »
« Je trouve que mes missions dans l’ensemble sont stimulantes. En fait je suis au cœur des discussions sur les périmètres scientifiques et éditoriaux des plateformes, donc par rapport au positionnement sur les publications des pays du sud, sur la pratique de frais de publication, sur la question de périmètre disciplinaire. Tout ça c’est assez intéressant et stimulant. Je travaille avec la directrice directement, avec qui les choses se passent bien, les relations au travail se passent bien, l’équipe est vraiment vraiment très chouette. Donc il y a le côté mission, mais aussi le côté cadre : on a des grands locaux à Marseille avec un jardin où on peut manger au soleil tous les midis. Je me suis fait un réseau de connaissances, collègues, amis au travail. On partage tous une appétence pour les SHS en fait, peu importe les postes que ce soient, certains développeurs, informaticiens, personnes du service données. On a tous un lien, plus ou moins, avec le monde de la recherche et surtout des SHS et donc c’est agréable. Il y a pas mal de collègues qui ont fait des thèses en sociologie. […] C’est un cadre de travail assez stimulant en fait par rapport à la recherche académique et à la science ouverte, aux données. On est au cœur en fait de ce qu’on appelle les humanités numériques chez OpenEditions et ça c’est très très chouette. Après y’a tout le côté liberté. La liberté que j’ai au travail. Vu que je suis sous la responsabilité directe de la directrice, j’arrive un peu quand je veux, je pars quand je veux, j’ai trois jours de télétravail par semaine. Tant que je fais mes missions, les choses se passent bien, personne ne surveille mes allées et venues, ce qui est très agréable. »