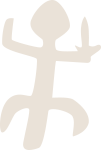« Je suis salariée d’une association qui s’appelle les Franca 67, qui est une association d’éducation populaire. Je suis dans cette asso depuis un an et demi maintenant. Et alors quel emploi j’occupe là-bas… C’est toujours un peu compliqué, à la fois dans les milieux associatifs, mais aussi dans les milieux qui font du care ou du social, c’est qu’on est tous et toutes super polyvalents. C’est pas dans la fiche de poste, mais y’a la théorie, puis y’a la pratique et, de manière empirique, on fait énormément de choses. C’est-à-dire que, moi sur mon contrat de travail, je suis animatrice médiatrice, dans les faits, la quantité de travail qui est consacré à s’occuper des enfants est assez minime comparée à toutes les autres missions que je fais. Enfin voilà, en gros y’a préparation des activités, on fait des activités avec les enfants les mercredis après-midi et pendant les vacances et on fait du soutien scolaire aussi pour les enfants qui sont en difficulté, on organise des évènements, notamment un festival au début de l’été. Parce que du coup l’asso dans laquelle je suis, enfin le pôle dans lequel je suis dans l’asso, travaille à la cité Rotterdam. Première cité HLM de France d’ailleurs, 1950. Et c’est un quartier assez défavorisé. C’est un quartier qui est passé en zone prioritaire y’a deux ans, je crois. Y’a pas beaucoup d’infrastructure publique, les familles sont assez livrées à elles même et du coup on a une fonction de lien social, mais pas que. On accompagne aussi beaucoup les jeunes, mais les jeunes c’est très large en fait, c’est aussi les familles, et notamment les mamans qui sont quand même très investies dans la vie du quartier. Donc voilà, notre mission principale c’est de nous occuper des enfants, dans les faits, on fait beaucoup de coordination c’est nous qui nous occupons aussi de faire nos demandes de subvention, de faire nos appels à projets, tout ça… […] Donc ça, ça prend énormément de temps aussi. »
« En quoi consistent mes missions…Bah c’est très large, mais c’est du divertissement clairement parce qu’on fait de l’animation avec les enfants, donc il y’a un volet divertissement, animation qui est super présent. Y’a une dimension coordination au sein de l’association. Parce que la faction régionale dans laquelle je suis - parce que les Francas en fait c’est une association nationale, mais si tu regardes les missions des Francas Franche-Comté, par exemple, ils vont pas du tout avoir la même organisation que là notre - nous on a une organisation qui est en quasi-totalité horizontale. On essaie en tout cas au maximum d’avoir une organisation horizontale, d’essayer de prendre tous et toutes une part égale aux missions, notamment aux prises de décisions aussi. Donc en fait y’a un gros volet coordination de l’association. On n’a pas de coordinateur dans les équipes, donc c’est des rôles qui tournent et ça demande énormément de boulot aussi, d’administratif, de demande de subvention, d’organiser les réunions, de tout ça… Y’a un autre volet, du coup, qui est un peu large et qui se recoupe dans plein d’autres petites missions, qui est le côté politique en fait. Politique au sens, comme nous on l’entend en tout cas dans notre asso. Pour nous l’éducation populaire c’est politique parce qu’en fait on considère qu’on n’est pas tous et toutes égaux et égales face à l’éducation, par rapport à ton origine sociale, par rapport à ce que tu as vécu, à l’histoire de ta famille, à tes ressources économiques, à tes origines ethniques, religieuse ou que sais-je. […] Pour nous on a aussi une fonction « représentative », aux yeux de nos partenaires et notamment de la mairie. Parce que du coup, ce sont des populations qui ne sont pas forcément visibilisées et du coup, on a aussi une fonction de …. De valoriser le quartier, de valoriser ce qu’on fait, pas au sens « c’est nous qui l’avons fait », mais au sens « voilà en fait ce qu’il se passe dans ces quartiers-là » et dans une plus large mesure, essayer d’éviter tout ce qui est cliché, discrimination sur les jeunes de quartier, sur les familles issues de l’immigration, les familles musulmanes. »
« Et là où pour le coup l’ethnologie aide énormément j’ai l’impression c’est que, c’est hyper important de pouvoir comprendre culturellement ce qui se passe dans ces milieux-là. Parce qu’en fait, la cité Rotterdam, c’est une toute petite cité à forte majorité de personnes musulmanes qui est complètement enclavée dans l’Orangerie, qui est un quartier très bourgeois pour le coup et à majorité de personnes juives de confession. Donc rien que ça, même si c’est pas un conflit ouvert ou quoi que ce soit, ça joue. Ne serait-ce que pour les opportunités que les enfants peuvent avoir. Par exemple y’a un centre socioculturel à l’Orangerie, mais les activités qu’il propose ne sont pas forcément adaptées aux gens qui ont pas beaucoup de sous et… Enfin voilà, depuis octobre dernier, ce qui se passe en Palestine, la guerre et tout ça, les enfants en ont conscience, sans en avoir conscience et c’est pas à l’école qu’ils peuvent discuter de ça. Donc on a aussi une fonction politique là-dedans, parce qu’ils vont avoir beaucoup plus de facilité à nous poser des questions à nous que de poser des questions soit à leur instit, soit à d’autres adultes quoi… Donc on à ce rôle-là aussi quoi. C’est sûr que c’est compliqué et responsabilisant. Mais moi je suis très contente que l’asso ait ce rôle-là. »