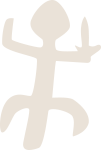Au début de sa thèse, avant de devenir ATER, Ayoub était vacataire à l’Université de Strasbourg et à Science Po Reims. C’est à travers cette première expérience d’enseignement qu’il s’initie au métier d’enseignant.
« Actuellement j’occupe un poster d’ATER à l’Université de Strasbourg. Ce que je fais c’est tout simplement de l’enseignement. J’essaie de faire de la recherche à côté parce que je suis en quatrième année de thèse en même temps. Mon travail consiste à donner des cours dans plusieurs parcours et formation à l’Université de Strasbourg (anthropologie, médecine, sociologie et master inégalités et discrimination). [...] En général, quand vous êtes ATER on va vous donner des cours qui se rapprochent de votre objet d’étude. Par exemple, dans le master discrimination, je donne un cours sur l’immigration, conflits et frontières. Et après, on peut donner des cours plus méthodologiques. Par exemple, en M2 en Anthropologie sociale et culturelle, je donne un cours sur l’analyse des données ethnographique. Donc c’est un travail sur la rédaction et l’analyse. [...] Je donne un volume horaire de cours de 192 heures, mais je participe aussi un peu aux activités de recherches dans mon laboratoire et à la faculté des sciences sociales de manière générale. Et je suis des étudiants dans leur mémoire quand ils travaillent sur des questions migratoires. C’est super intéressant et super « formateur » de revenir sur son lieu de formation, mais de l’autre côté du bureau. »
« Quand on fait une thèse, il y a un schéma plus ou moins linéaire. Quand on commence à voir le bout, c’est-à-dire la fin de sa thèse et qu’on commence à penser à soutenir, généralement à partir de la troisième année, on peut postuler à ce poste d’ATER. En fait c’est valorisant parce que ça permet d’être familier avec l’expérience de donner cours, plus ou moins toute la semaine et parce qu’après la soutenance on peut faire valoir qu’on sait donner cours, qu’on sait un peu être intégré dans la vie d’un laboratoire, dans la vie de la faculté des sciences sociales. En général on le fait soit avant la thèse, soit après la thèse. Et je trouve que le faire avant c’est valorisant parce que ça me permet de continuer dans cet aspect un peu linéaire de la recherche avec après un postdoc et après postuler pour un poste de maître de conférences. C’est un peu une étape à franchir dans la vie d’une personne qui veut faire de la recherche »
« Une journée type c’est, on se réveille, on prépare ses cours et, on le dit pas souvent, enfin, on le dit pas assez en tout cas, mais préparer des cours, ça prend du temps. Par exemple, pour une heure de cours généralement c’est multiplié par 3, 4, voire 5. Surtout les CM. Les TD c’est plus participatif. Mais les CM c’est des cours magistraux du coup ça demande un peu plus de temps et du coup une journée type c’est une journée de préparation de cours tout simplement. Du coup, soit je prépare mes cours, soit je lis, je fais de la recherche, dans mon cas, de la rédaction de ma thèse. Faut faire les deux [thèse et ATER] donc on apprend rapidement à la fac à jouer sur plusieurs tableaux. Et après il y a tous les « à côté » qui sont valorisant. Par exemple je fais partie du comité d’organisation de deux séminaires dans mon laboratoire. »
« Ce que j’aime plus, c’est cet aspect enrichissant de l’enseignement. J’aime bien me trouver 2/3 clés très intéressantes par rapport à ma thèse en lisant des ouvrages qui sont très éloignés, et c’est cet aspect un peu aléatoire en fait, de trouver les clés, chercher à travers des découvertes un petit peu inattendues. Du coup moi j’aime bien cet aspect par rapport à l’enseignement. Enfin... J’établis pas une rupture entre « enseigner » et « faire de la recherche ». Généralement j’essaye de faire les deux en même temps et en fait il y a des continuités très stimulantes. En tout cas pour moi. […] Faire du terrain, lire, écrire, j’aime bien. »