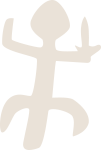« Alors les points forts à mettre en avant pour moi c’est vraiment toutes les compétences transverses. […] Là où ça va jouer, c’est vraiment de mettre en avant toutes les compétences qu’on a, auquel on ne pense pas forcément, donc il faut vraiment s’appuyer sur « là concrètement qu’est-ce que j’ai développé comme compétences pendant mon Master. » Déjà des capacités d’observation. Parce que le cœur du terrain c’est savoir observer ce qu’il y a autour de nous. On est parmi des gens, on ne comprend pas nécessairement grand-chose de ce qu’il se passe, mais on essaye au moins d’observer, de voir. Ensuite on a plein de données, même si on ne les comprend pas trop. Et ensuite on analyse. Donc ça, c’est la deuxième chose : l’esprit d’analyse. C’est-à-dire à partir de données, qu’est-ce qu’on en tire, qu’est-ce que ça veut dire, avec quoi on les met en lien pour comprendre ce qu’il se passe. Déjà observation, analyse, c’est quand même la majorité des jobs. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est capacité de recherche. Au sens général, pas au sens « recherche académique ». Ça veut dire qu’on a besoin d’une information, on ne l’a pas, comment on la trouve ? Et ça dans n’importe quel parcours universitaire, mais je pense que c’est encore plus vrai en sciences humaines et sociales, et bien on a plein de méthodes pour trouver l’information. Évidemment, la première chose qu’on fait, c’est taper dans Google la recherche qu’on veut et parfois ça donne un peu des pistes. Mais il faut croiser les sources, aller quand même sur les sources d’information plus spécifique sur le sujet, savoir où chercher, savoir quoi demander, trouver vraiment qu’est-ce qui va nous apporter les éléments dont on a besoin et bien sûr les mettre en lien avec ceux qu’on connait. »
« C’est un peu savoir tisser de liens, prendre des bouts d’informations ici et là, les connecter, comprendre ce que ça veut dire. Je pense que c’est aussi beaucoup ça qu’on fait sur le terrain en fait. Il y a aussi toute la partie rédaction. Parce que, dans beaucoup de job, on va demander de rédiger des trucs. Ça peut être rédiger un rapport pour dire qu’est-ce qui a été fait jusque-là, rédiger des recommandations pour dire dans ce projet qu’est-ce qu’on va faire, qu’est-ce qui serait intéressant. La rédaction c’est toujours très important parce que le texte c’est quelque chose qui est un peu au cœur du monde du travail. Donc savoir bien rédiger, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais c’est quelque chose qui est quand même très important et qu’on fait tout le temps. Évidemment, en anthropologie, quand on sort un mémoire de 200 pages, à priori, niveau rédaction, ça donne un petit boost. L’inverse aussi du mémoire, savoir synthétiser. C’est aussi important. Typiquement là : je parlais des analyses d’université que je fais. Ma boss n’a pas envie de lire trois pages dessus, elle a envie de lire un petit paragraphe qui explique pourquoi c’est bien, pourquoi c’est pas bien. Donc savoir synthétiser les informations essentielles, c’est aussi quelque chose de très important. En tout cas, voilà, c’est beaucoup de compétences transverses, que l’on utilise dans différents domaines et qui sont utilisées dans plein de métiers différents. »
« Observation, analyse, rédaction, synthèse. Vraiment tous les jours, on me demande de rédiger des trucs, d’analyser un établissement, un message que l’on a reçu, de comprendre ce qui se passe. Tous les jours je dois faire des recherches sur un sujet ou un autre. Là on veut mettre en œuvre une nouvelle procédure pour la délivrance de bourse dans notre alliance Épicure, et bien il faut que je fasse des recherches sur comment les autres alliances le fond, quelles sont les procédures qui existent au niveau de l’agence ERASMUS, faire un peu des recherches pour voir ce que nous on peut faire. »