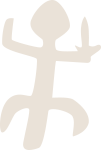Faire siens les morts incertains
Programme ANR Pri-MI 2024-2026
Dans le sens commun, la mort apparait souvent comme un point final, associée à l’idée d’immobilité, d’ancrage dans une dernière demeure, de repos éternel. Pourtant, les travaux en sciences sociales conduits au sein du champ dynamique de l’anthropologie de la mort et portant sur la matérialité des morts nous invitent à nuancer cette vision. Les recherches récentes ont en effet souligné la multiplicité des modes d’existences des morts, soit à travers leurs restes matériels soit à travers les relations que les vivants entretiennent avec eux, avant ou après le traitement funéraire s’ils en font l’objet.
Ce sont précisément ces trajectoires post-mortem que ce séminaire entend explorer. En s’attachant à la description empirique d’itinéraires et de parcours de corps morts, il s’agit de questionner l’agentivité d’une matière régulièrement conçue comme « passive », « inerte » pour comprendre comment elle mobilise les vivants. Le « corps mort » sera ici entendu dans une acception large, puisqu’il pourra – suivant les cas – s’agir de cadavres comme de restes à la matérialité plus ténue (os, cendres, coupes anatomiques, voire traces). Nous placerons ainsi au cœur de notre réflexion les « trajectoires » variées des restes, en l’ouvrant sur des contextes divers et à l’éclairage interdisciplinaire.
Nous nous attacherons tout particulièrement à questionner ce que les trajectoires des restes peuvent nous apprendre sur :
– Les normes de traitement des restes, leurs écarts et franchissements, et les situations-limites
– Les acteurs qui prennent en charge les restes et leurs motivations
– Les effets mémoriels et les affects provoqués par ces trajectoires.
Toutes les séances se déroulent à la Misha, de 14h à 16h.
Séance préliminaire : Jeanne Teboul (LinCS) et Clara Duterme (LinCS), 26 septembre 2025 (Misha, salle Océanie)
“Faire siens les morts incertains” : présentation des activités et des avancées du programme de recherche
Cette séance sera l’occasion de présenter, notamment aux collègues du laboratoire LinCS, le programme de recherche “Faire siens” les morts incertains (Pri-MI) financé par l’ANR, qui a été mis en place depuis 2023 au LinCS par Jeanne Teboul et Clara Duterme. Celles-ci viendront présenter les grands axes et avancées du projet, ainsi qu’un éclairage sur les thématiques qu’elles explorent sur leurs terrains de recherche respectifs autour des restes humains issus d’un crime nazi (France) et de victimes exhumées dans le contexte post-conflit (Guatemala).
La séance sera suivie d’un moment de convivialité (16h – 17h).
Séance 2 : Marion Bertin (Programme “Remain Human”, Université Catholique de Louvain), 20 février 2026 (Misha, salle Amériques)
« REMAIN HUMAN : collections de restes humains originaires du Congo conservés en Belgique »
Depuis plusieurs décennies déjà, les collections de restes humains conservés dans des musées et des laboratoires posent question, en particulier lorsque ces restes humains sont liés à un contexte colonial. En Belgique, le projet HOME a permis d’établir un premier inventaire, non exhaustif, de telles collections dans les institutions fédérales. Le projet REMAIN HUMAN propose quant à lui une analyse des pratiques et des négociations autour des collections de restes humains originaires du Congo et conservés dans les collections en Belgique. A l’appui de recherches ethnographiques, il s’agit notamment de mieux comprendre la prise en charge de ces collections, les acteurs et actrices impliquées ainsi que les enjeux de recherches et d’éventuelles restitutions qui les entourent.
Séance 3 : Dorothée Delacroix (IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle), 27 mars 2026 (Misha, salle Amériques)
« Exhumations sous haute tension. Mobilisations contestées des voisins des fosses du franquisme en Navarre »
“Jamais je ne mangerai leur nourriture !” C’est ainsi qu’une femme, à la recherche des restes de deux membres de sa famille, s’est exprimée à l’égard d’un groupe de voisins du lieu de la fosse qui s’organisait bénévolement pour apporter à manger à tous les participant-es durant l’exhumation. Cette présentation visera, d’une part, à analyser la tension latente au cours de cette excavation (dont je maintiendrai la localisation anonyme), notamment à travers la notion de “murmures accusatoires” forgée en contexte péruvien (Delacroix 2025). D’autre part, il s’agira de démêler les fils de l’histoire locale de la violence dans cette partie de la Navarre rurale pour mieux comprendre l’engagement complexe des voisins en question dans l’effort de “récupération de la mémoire historique” et de recherche des victimes du Coup d’état militaire et de la dictature franquiste. Pourquoi leur récente, mais intense, mobilisation autour des fosses qui parsèment le territoire où ils vivent est-elle contestée ? Comment appréhender leur effort de prise en charge de cette mémoire et de ces morts au prisme de leur trajectoire complexe, non sans lien avec l’histoire – sur la longue durée – du carlisme et du conflit basque.
Séance 4 : Jean-Christophe Colinet, (LinCS UMR7069 Université de Strasbourg/CNRS), 17 avril 2026 (Misha, salle Amériques)
« Le devenir des cendres humaines dans des pratiques contemporaines. Certitudes juridiques et incertitudes anthropologiques »
A la loi française de 2008, qui entend encadrer précisément le devenir des cendres, des endeuillés répondent par des pratiques qui sont variables et peuvent s’écarter sensiblement du cadre juridique fixé. Pour eux, il s’agit de sortir les cendres de leur incertitude, soit par un mode de dispersion qui les rapporte à un choix de vie du défunt, soit en créant une trace plus durable, qui permet de garder son image.
Séance 5 : Laure Cadot (RES PERSONA), 22 mai 2026 (Misha, salle Amériques)
« Les restes humains au musée : mécaniques et enjeux contemporains de leur patrimonialisation au travers de l’exemple des restes issus de contextes coloniaux »
Bien qu’ils ne représentent qu’une faible proportion des individus présents dans les collections, les restes humains issus de contextes coloniaux ont contribué à mettre en lumière la problématique des corps patrimonialisés au tournant du XXIe siècle. Quels sont ces restes ? Qui sont-ils et elles ? Quelles ont été leurs trajectoires, leurs usages ? Comment les perçoit-on aujourd’hui ? L’histoire de la constitution de ces collections et leur caractérisation matérielle et mémorielle viendront mettre en lumière les enjeux spécifiques auxquels ces individus confrontent les professionnels du patrimoine, mais aussi la sphère politique et la société civile dans son ensemble. Au travers de la démarche spécifique de conservation-restauration nous nous efforcerons de démontrer en quoi l’approche matérielle peut contribuer à la mise en place d’une prise en charge éthique adaptée.
Le lien vers le blog du programme : https://primi.hypotheses.org/1975